
INTRODUCTION
Dans un XVIIe siècle marqué par le culte du moi du Roi Soleil, La Bruyère écrit dans sa Préface (p. 117) « Je rends au public ce qu'il m'a prêté: j'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage ». Chez Leonard DE VINCI l'on a retrouvé un miroir où il était écrit « Ô femme, ne te plains pas de moi car je ne te rends que ce que tu m'as donné ». Le parallèle entre ces deux phrases n'est pas négligeable: La Bruyère renvoie par écrit l'image qu'il reçoit de la société, le miroir renvoie l'image de la femme qui le regarde.
Par un processus spéculaire donc par une image renvoyée par un miroir, comment en ces deux remarques La Bruyère dépeint-il d'une manière profane la coquette, aveuglée par elle-même, se donnant à voir et critiquant les autres, tout en laissant sous entendre un retour à l'amour de Dieu?
Avant de commencer il convient de se demander pourquoi étudier ces deux remarques de concert? Tout d'abord notons l'édition: toutes deux datent de la septième, celle de 1662 grossissant le chapitre « Des femmes » de quatorze remarques, alors que les remarques les encadrant sont de d'autres éditions. L'on comprend donc qu'il y a une réelle cohérence entre les deux et en effet, en plus de relever toutes deux du modèle emblématique de la coquette, l'on voit que, là où la septième remarque tient un propos général plutôt réflexif la seconde la sert en l'étayant par un portrait, de l'ordre du figuratif de fait, celui de Lise.
Lecture de la remarque 7.
Remarque 7: une remarque réflexive et générale.
La première chose à remarquer est certainement cet indéfini débutant la remarque: « Une femme coquette», ce qui nous place directement dans l'ordre du propos général. Vous constaterez qu'en cela elle diffère d'emblée des remarques que nous avons étudiées puisqu'elle ne prend pas en charge un portrait spécifique.
Avant de rentrer réellement dans l'analyse je préciserai un point de vocabulaire. Souvenez-vous de Nicandre (remarque 82 de « De la société et de la conversation ») où l'on avait remarqué la métaphore militaire filée dans le texte. Nous pouvons préciser que chez les moralistes cette métaphore est parfois retrouvée dans ce sens où la vie humaine et les échanges humains peuvent être vus comme une guerre permanente. Ce type de métaphore se retrouve ici et dans le « ne se rend point », il faut comprendre cet acte de ne pas rendre les armes donc par extension de ne pas abandonner. Cette femme n'abandonne pas, ne perd pas de vue, en l'occurrence ici sa passion de plaire et l'opinion qu'elle a d'elle-même.
Il est de rigueur de se demander ce qu'est une « coquette »? Qui sont donc ces coquettes qui apparaissent dans de nombreuses remarques telles que la 18, la 22, la 41, la 44... du même chapitre? Je ne remonterai pas à l'étymologie pour l'instant mais je répondrai en citant La Bruyère. Alors qu'il semble recueillir les diverses « espèces » de femmes avec la curiosité de l'entomologiste, entre la femme galante, la femme faible, la femme inconstante et j'en passe, la coquette à la remarque 22 du même chapitre est définie comme une femme qui « veut passer pour belle ». Mais ne nous méprenons pas, ce n'est guère un passe temps ou quelque chose de faible envergure, non, pour la coquette, ce soucis d'être belle, ce fait de plaire, est une véritable « passion ».
Cette passion nous renvoie sensiblement à ERASME dans le sens où la passion et la folie peuvent aisément s'unir. Et de fait la Philautie, cet amour de soi-même, fait sa première apparition dans notre remarque. La passion de plaire c'est aussi ce miroir de vanité tel qu'a pu le décrire Michel FOUCAULT, ce miroir qui permet de s'adorer tel que l'on se rêve, ce miroir fonctionnant comme un emblème de la folie à travers cet amour démesuré de soi.
« Qui veut passer pour belle » nous disait donc la remarque 22. Un nouveau thème est lancé, nous nous situons dans un soucis du paraître mettant donc au centre les apparences. Et rien que dans ce début de texte l'on rencontre le verbe « plaire », le substantif « opinion » (même si c'est l'opinion qu'elle a d'elle-même). Notre coquette se trouve de fait placée dans un cadre mondain alors même que l'on va la découvrir par la suite dans l'intimité d'un cabinet.
Ces éléments semblent annonciateurs ce qui va suivre On imagine cette passion de plaire ne pouvant se satisfaire d'elle-même, et ayant besoin des autres: comme Iphis qui allait à l'Eglise pour être vu, on pense une coquette qui chercherait à plaire au regard des autres.
Et en effet le verbe « regarder » apparaît. Mais comme pour le substantif « opinion » précédant où l'on pouvait s'attendre à une opinion qui aurait été celle des autres, là encore ce regard est celui de la femme coquette et non celui d'autrui. Mais pour le moment ce regard est pris en son sens figuré, « elle regarde le temps et les années ». De cette constatation on peut donc être amenés à se demander si la coquette a réellement besoin du regard des autres, ou tout simplement des autres. Elle semble se suffire à elle-même et cette passion de plaire prend les allures d'une réelle passion de soi comme nous avons déjà pu le remarquer. On en arrive en quelques sortes à la triste conclusion qui éclate dans le Misanthrope de Molière représenté pour la première fois en 1666: Célimène se préfère à Alceste, Alceste à Célimène et au final chaque personnage se préfère à tous les autres. La coquette se passionnant par elle-même se préfère elle aussi aux autres selon la même analyse.
Mais sans quitter notre livre regardons les Caractères de THEOPHRASTE, à la page 107, dans « De l'orgueil », il écrit: « Il faut définir l'orgueil une passion qui fait que de tout ce qui est au monde l'on n'estime que soi ». Vous conviendrez que l'on n'est guère loin de notre coquette ici.
Peut-être avez-vous été sensibles, à la lecture de cette remarque, au fait que le narrateur, contrairement à d'autres textes, n'apparaissait pas grammaticalement dans le sens où il n'y a pas de « je ». Mais il est omniprésent et cette phrase l'illustre: « elle regarde le temps et les années comme quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit les autres femmes». Ce « les autres femmes » sous-tend très clairement, et donc avec une ironie satirique que le temps et les années rident et enlaidissent les autres femmes mais pas la femme coquette.
Et de fait La Bruyère n'en reste pas là, à cela il ajoute, narrateur extérieur à la scène, que la coquette
Là encore ce n'est pas dit clairement mais l'image n'est pas longue à venir. On imagine aisément la coquette assise devant son miroir, dans l'intimité de sa chambre, en train de se farder, de s'orner les cheveux de fleurs, de se parler de perles... La coquette se faisant belle.
Mais a-t-elle conscience qu'elle use d'artifices pour paraître ne pas avoir son âge?
Arrêtons-nous quelques instants sur le substantif de « parure ». Il ne faut pas seulement entendre l'habillement d'une personne mais aussi ses ornements, ses bijoux. Lors de sa toilette la coquette se pare pour l'extérieur, elle se crée l'image qu'elle veut donner dans le monde. Cette parure, pouvant apparaître comme appartement à la théâtralité se place donc en tant que lien entre les coulisses (la chambre) et la scène (le théâtre mondain, la société).
Cette phrase est aussi intéressante par les réseaux d'oxymores que l'on y rencontre. En effet on a le verbe « embellir », qui s'oppose à celui de « défigurer » et au substantif « défauts ». Ici peuvent être utiles quelques remarques de grammaire. Soyons sensibles aux temps, « embellir » est au passé-composé, et par ce temps composé l'on peut lire l'aspect accompli donc dépassé de ce qui embellissait la jeunesse de la coquette là où « défigurer » est au présent.
Notons aussi, en ce qui concerne les verbes un point intéressant: le verbe « embellir » est utilisé pour désigner la « jeunesse » alors que celui de « défigurer » pour la « personne ». La jeunesse est beaucoup plus abstraite que la notion de personne que l'on peut se figurer, de fait l'aspect mélioratif du verbe « embellir » se trouve dégradé par le fait qu'il renvoie à une entité abstraite.
Et en ce qui concerne l'autre verbe positif de cette phrase « éclairer », il en perd tout ce côté en éclairant des défauts. Il exhibe les défauts de la vieillesse et n'est pas l'écho qu'il aurait pu être de la jeunesse.
Mais le jeu sur les mots ne se limite pas à la « jeunesse » qui débutait la phrase en effet est supplantée par la « vieillesse », inévitable, qui l'achève et qui de fait est l'impression qu'il nous reste.
Je ne me suis pas arrêtée sur la ponctuation jusqu'à maintenant mais il est intéressant de remarquer que la phrase précédente s'achevait par les deux points laissant place à une explication classiquement. Et suite à ces deux points:
Comprenez par « mignardise » une « affection exagérée de gentillesse et de délicatesse » et par « affectation » le fait d' « afficher une attitude peu naturelle et bien souvent peu sincère ». L'on retrouve ici notre contexte de théâtralité déjà suggéré par le substantif de « parure », et de fait la coquette semble, telle l'actrice faisant des mimiques, jouer un rôle en société: celui d'affecter d'être belle et gentille. Mais comme le remarque LA ROCHEFOUCAULD dans ses Maximes, à la 408: « Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes qui ont été aimables, c'est oublier qu'elles ne le sont plus ».
Et tout comme pour sa « passion de plaire », la coquette prend très au sérieux ce jeu théâtral et ce mensonge d'apparences elle le maintient même « dans la douleur et dans la fièvre ». La Bruyère montre ironiquement que ce soucis du bien paraître est inhérent à la coquette et qu'il prévaut même sur sa santé: les apparences avant tout.
Voici venu le temps de la pointe de La Bruyère, ce qui conclut le modèle emblématique en deux temps que nous avions annoncé. Alors que l'on a vu ce portrait d'une coquette se ternir au fil des lignes et des années, la chute arrive et c'est tout naturellement qu'elle est hyperbolique et caricaturale, à l'image de la coquette.
C'est ce qui s'appelle un « passage à la limite ». Au dernier instant de sa vie, après la douleur et la fièvre, la coquette est encore une coquette. Elle est un peu comme Cliton de la remarque 122 de « De l'Homme » (p. 435) qui, je cite « n'a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui est de dîner le matin et de souper le soir » et qui « donnait à manger le jour qu'il est mort, quelque part où il soit, il mange, et s'il revient au monde, c'est pour manger ».
La coquette qui ne voit vieillir que les autres est convaincue qu'elle peut arrêter le temps et elle semble mourir sans même s'en rendre compte. Il y a ici une « déraison calculée » certaine.
Transition: Dans cette analyse l'on a donc pu constater que La Bruyère écrivait sur le « talent » dirons-nous, d'une coquette à ne pas voir la réalité. La haute estime qu'elle a d'elle-même nous avait permis de parler de la Philautie déjà rencontrée chez ERASME. Cette figure, exacerbée par le motif du miroir, est centrale dans la huitième remarque que je vais désormais vous présenter.
Notons avant de réellement commencer que cette septième remarque, qui avait surtout une portée réflexive comme je l'ai dit en titre, se terminait par le seul réel élément imagé qu'elle contenait, la coquette « parée et en rubans de couleur », ce qui amorce certainement la peinture de la remarque 8 qui, en complémentarité, a une portée figurative où le topos pictural est beaucoup plus présent.
Lecture de la remarque 8.
Montrer le tableau Allégorie de la vanité (ou La vieille coquette) de Bernardo STROZZI: cette femme a jadis était belle comme les servantes qui l'aident à se parer mais le temps a fait son œuvre et même les bijoux les plus somptueux n'y peuvent rien. Peut-être est-ce là notre Lise...
Remarque 8: une remarque figurative, donnant à voir.
Nous voilà de retour dans les portraits que nous connaissons. Ce n'est plus une femme avec un déterminant indéfini, mais Lise. Cette Lise existait déjà dans la cinquième édition puisque la remarque 56 en faisait déjà un suggestif portrait.
Lecture de la remarque 56.
Ici l'on est cependant face à une autre version, plus achevée.
Dans cette phrase, bien qu'elle ne soit pas grammaticale, tout comme dans la remarque précédente, la présence du narrateur est palpable. En effet, elle entend dire « d'une autre coquette ». Nous nous doutons bien que Lise n'a pas conscience d'être elle-même une coquette. C'est donc ici la voix du narrateur. Remarquons qu'il n'en était pas de même pour la remarque précédente, bien que l'on aie vu une construction similaire à travers « elle regarde le temps et les années comme quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit les autres femmes ». Cet « autre » était celui du point de vue de la coquette et non celui du narrateur.
Cette voix du narrateur se lit aussi dans le jugement dépeint, des « ajustements qui ne conviennent plus à une femme de quarante ans ». On voit donc ici le regard critique du moraliste.
Je pense qu'est venu le moment, que j'avais retardé toute à l'heure, de s'interroger sur l'étymologie du substantif « coquette ». Dans le dictionnaire étymologique l'on trouve ceci:
Coquet: XIIIe siècle, « petit coq ». En 1611 l'on croise le verbe « coqueter » signifiant « se pavaner comme un coq ». Et entre parenthèses, le verbe « caqueter » au XVIe siècle, d'où le substantif de « coquette », « femme qui caquette ».
Peut-être rien qu'à écouter ce parcours étymologique aurez-vous remarqué l'allitération en [k]. Et de manière assez comique elle se trouve aussi dans notre première phrase. Relisons la, on entendrait presque cette coquette caqueter ou bien encore le caquet mondain.
Dans cette phrase l'on retrouve le substantif d' « ajustements » qui rappelle celui de « parure » de la septième remarque mais aussi l'opposition entre jeunesse et vieillesse. Peut-être que ce substantif de vieillesse peut vous choquer puisqu'il est ici seulement question d'une « femme de quarante ans », mais il faut bien savoir qu'au XVIIe siècle la femme de quarante ans n'était pas celle d'aujourd'hui et qu'elle avait plutôt le physique d'une femme de soixante voire soixante-dix ans.
Et ces quarante ans
C'est une fois de plus un écho à la septième remarque. Là où la coquette regardait « le temps et les années comme quelque chose seulement qui rid[ait] et qui enlaidi[ssait] les autres femmes », Lise pense que les années ne l'atteignent pas, de même que la coquette mourrait sans même s'en rendre compte. La correspondance parfaite entre la coquette de la remarque 7 et Lise la place une fois de plus en tant que coquette.
Le verbe « croire » est à double sens, la coquette usant d'ajustements veut faire croire à son jeu, celui qu'elle est belle, tandis qu'elle-même se croit plus jeune que ce qu'elle l'est vraiment, ou tout du moins elle croit passer pour plus jeune auprès des autres. Ce verbe « croire » se place donc dans l'introspection, un regard une fois de plus tourné vers soi-même.
Ici apparaît pour la première fois dans nos deux remarques, bien qu'il ait toujours été présent de manière implicite, le substantif de « miroir », celui que MOLIERE, à la scène 6 des Précieuses ridicules appelait « le conseiller des grâces ». Mais ce miroir n'est pas un miroir de vérité, c'en est un de vanité, il donne à voir à Lise ce qu'elle a envie d'y trouver.
Montrer le tableau Le miroir du diable, la coquette habillée, d'Antoine WIERTZ (XIXe siècle): Tout dans sa mise, dans sa tenue, montre la satisfaction de soi-même.
L'on retrouve ici la Philautie déjà abordée dans la remarque précédente, que ce soit dans le tableau que je viens de vous montrer ou dans cette phrase même. Cette admiration portée sur soi me permet d'introduire la notion d' « idole ». Il semblerait que Lise se soit créé un idole, avec du rouge et des mouches sur le visage comme on le verra plus loin; cet idole c'est elle-même. L'on a vu en cours, que l'idole s'opposait au Dieu chrétien, et que La Bruyère était chrétien. L'on peut donc en déduire que le moraliste a moins pour but de charger la coquette que de s'en servir pour parler de chrétienté. Mais pourtant, me direz-vous, que ce soit dans cette remarque ou dans la précédente il n'est pas question directement de religion, au contraire du portrait d'Iphis qui commençait sur une scène de messe. Et de fait, Louis van Delft, dans Poétique parle à propos de ce portrait de « parabole laïcisée ». Pourquoi? La parabole se définit comme un « court récit allégorique, symbolique, sous lequel se cache un enseignement religieux »... Par ce portrait de Lise, qui on le verra à la fin est « ridicule », La Bruyère, malgré une présentation de manière profane, invite donc à revenir à Dieu et à ne pas se perdre dans sa contemplation. Rappelons-nous, même si ce n'est pas biblique, que de trop se regarder, Narcisse en est mort...
Je poursuis avec Louis van Delft qui, comme il l'est indiqué dans la note 2 souligne « la manière entièrement spéculaire » de cette remarque et particulièrement de ce passage. Par « spéculaire » il faut entendre « qui est produit par un miroir » justement. En effet, Lise est assise devant son miroir mais elle n'est pas la seule. L'on a déjà parlé en cours d'une « satire à détente multiple », on peut la retrouver ici. Si le mot « satire » dérange, l'on peut utiliser celui de « réflexion ». Lise, face à son miroir ne se voit pas telle qu'elle est. Mais ces Caractères de La Bruyère, bien qu'ils aient été écrits au XVIIe siècle, ne restent-ils, pour nombreux d'entre eux, extrêmement contemporains? Ainsi face à cette Lise, La Bruyère ne fait-il pas aussi le portrait du lecteur? Lise est donc devant son miroir mais le lecteur l'est tout comme elle. Et surement y a t il un message de La Bruyère ici: Lise est aveuglée, mais vous, ne le soyez pas.
Ce lecteur, ce spectateur placé face à un miroir est chose courante, et puisque l'on est lancé dans la peinture, voici un tableau qui l'illustre. Montrer le tableau La Vénus à son miroir, de Diego VELASQUEZ (XVIIe siècle): L'on peut voir une Vénus consciente de sa beauté et qui s'en émerveille, comme si cette beauté se suffisait à elle-même. De l'allégorie de la beauté l'on est passé à son narcissisme. Et ce qui est intéressant aussi c'est que l'on peut penser que Vénus nous voit dans le miroir tenu par Cupidon et qu'elle contemple l'effet que sa beauté produit sur nous.
Toute à l’heure nous avions dit que cette remarque était réellement empreinte du topos pictural, et de fait ici l’on peut voir une focalisation sur les détails avec la « mouche »de Lise ou bien encore dans le chapitre « Des Biens de Fortune », à la remarque 83, le « mouchoir » de Giton. De même pour le rouge, c'est aussi celui qu'Iphis mettait, mais rarement, sans en faire habitude. Cette remarque 8, contrairement à la 7 est beaucoup plus précise grâce à ce zoom en quelques sortes sur le visage de la coquette.
Puisque je parle de « zoom » et que l'on vient d'étayer le motif du miroir, il me semble à propos de vous renvoyer, si vous en avez l'occasion, aux annexes des Contes de PERRAULT où, dans « Le Miroir ou la Métamorphose d'Orante » l'on peut reconnaître dès le début, concernant l'un des trois frères d'Orante, un miroir concave ou « miroir ardent », qui représente les objets « plus gros, (et fait aussi sortir l'image au dehors jusqu'à son foyer) ».
Revenons à Lise, de son visage d’ailleurs on n’en voit ce rouge et ces mouches : les artifices dont Lise fait usage, comme si ce visage s'y résumait. Là aussi la théâtralité est centrale : Lise semble se déguiser avant de monter sur scène, de rejoindre le théâtre mondain.
L’on avait défini dans un cours précédent l’honnête homme comme celui qui avait « l’art d’être soi sans imposer son moi ». La coquette elle, n’est pas elle puisqu’elle se crée une image et refuse de se montrer telle qu'elle est, et son moi bien souvent elle l'impose. Je me réfère pour cela à la remarque 84 du chapitre « De l'Homme », où l'on a le portrait d'Argyre qui, emportée par la certitude de plaire, parle toujours et n'a pas d'esprit. Ainsi la coquette serait-elle aussi, et doublement, un modèle en creux de l'honnête homme, (doublement car la coquette est une femme).
Rappelez-vous la première phrase où nous avions été sensibles à l'allitération en [k]. Cette remarque est décidément un réel jeu sur les sons puisque l'on peut constater ici la récurrence de l'assonance en [ou] dans « rouge » et « mouches ». Louis van Delft, il me semble, voit en cela la moue de dédain de la coquette toujours en position de critiquer l'autre. Mais tout en gardant cette idée de moue l'on peut imaginer la coquette faisant la moue pour, justement, se teinter les lèvres. Ou bien encore la coquette faisant la moue, (ou les « grimaces et de contorsions » de la remarque 56) en se regardant devant son miroir, telle une actrice qui répèterait son rôle tout en guettant et corrigeant chaque variation de ses expressions: la coquette s'entrainant pour son entrée en scène une fois de plus.
Voici venue la chute de la remarque. Le début de phrase semble être l'écho de la première « Lise entend dire d'une autre coquette qu'elle se moque de se piquer de jeunesse et de vouloir user d'ajustements qui ne conviennent plus à une femme de quarante ans; ». L'on avait constaté l'aveuglement quant à son propre âge, et il est ici de retour. J'ai dit « écho de la première phrase » mais peut-être devrais-je dire « reflet ». La Bruyère, dans son portrait écrit une phrase qui se reflète ensuite dans toute sa remarque.
Notons seulement ce « pas permis » qui n'est pas sans faire penser au « Il y a du péril à contrefaire » de la remarque 56.
La première chose qui se donne réellement à voir, après l'entrée d'un second personnage, Clarice (qui n'apparait d'ailleurs qu'ici), est le retour du rouge et des mouches. Seulement l'ordre est inversé: pour Lise c'était d'abord le rouge puis les mouches, pour Clarice ce sont les mouches puis le rouge. Il y a donc une construction en chiasme. Et comme Monsieur Roukhomovsky m'en a fait la remarque, l'on peut voir ici l'effet d'un miroir renvoyant l'image opposée. Souvenez-vous dans Alice aux pays des merveilles de Lewis CARROLL, Alice s'interrogeant lorsqu'elle tient une pomme dans sa main gauche et que son reflet dans le miroir tient la pomme dans la main droite...
Ainsi par ce retournement de situation, la pointe remplit une fonction assez analogue à l'hyperbate (sauf qu'ici ce n'est pas grammatical) puisque par cet ajout l'on est invité à relire, et ce qui pouvait passer pour de la coquetterie, et c'est le cas de le dire, en devient ridicule.
Lise, à quarante ans, se moque donc de Clarice qui « fait la jeune ». Ce dont elle ne se rend pas compte, et ce dont nous l'on se rend compte grâce au chiasme notamment, c'est que Clarice en réalité est le miroir de Lise dans lequel cette dernière ne se reconnaît pas. Elle qualifie Clarice de « ridicule », sans se rendre compte que ce qu'elle critique elle le reproduit à l'identique. D'ailleurs à la remarque 56, le narrateur, grammaticalement présent pour le coup, n'hésite pas à dire « et elle-même devient difforme, elle me fait peur ».
Cet achèvement par l'adjectif est réellement lapidaire puisqu'en tant que dernier mot il est celui que l'on retiendra. Tout comme notre coquette de la remarque précédente qui restait coquette jusqu'à sa mort, Lise reste dans le faux, qui atteint son paroxysme ici, jusqu'à la fin.
On pourra être sensible au fait que ce « ridicule » se trouvait déjà dans la remarque 56 « Lise, déjà vieille, veut rendre une jeune femme ridicule ». Elle voulait la rendre ridicule mais pourtant, dans la même phrase le verbe « imiter » était utilisé. En introduction j'avais dit que la remarque 8 était plus achevée que la 56 et c'est en ce sens que là où elle se contentait de chercher à « imiter » dans la remarque 56, dans la 8 elle est réellement le « miroir » d'une autre coquette.
CONCLUSION
En conclusion ces deux remarques sont réellement complémentaires et si j'ai fait une explication linéaire ce n'est pas pour les séparer mais pour ne pas dénaturer l'organisation de La Bruyère tout en montrant la progressivité entre les deux. Bien que l'on puisse se questionner, à la vue de ces peintures aux allures quelques peu misogynes, sur ce que La Bruyère a réellement voulu dire des femmes, peut-être que la question n'est pas là et qu'il faut en retenir, de concert avec Louis van Delft, cette notion de parabole laïcisée opposant la Philautie à l'amour de Dieu. Ou, sans considérer cet aspect religieux, penser avec MARIVAUX dans Le Spectateur français à la feuille 1, que se trouver, tel le lecteur, face à un miroir que serait la remarque, serait un genre d'expérience cathartique ramenant aux vraies valeurs. Je cite: «Si les portraits qu'on a fait de vous dans tant de livres étaient aussi parlants que l'est le tableau sous lequel il vous envisage […] [Alors] ces prestiges de vanité qui vous font oublier qui vous êtes, ces prestiges se dissiperaient, et la nature soulevée […] vous ferait sentir qu'un homme, quel qu'il soit, est votre semblable ».




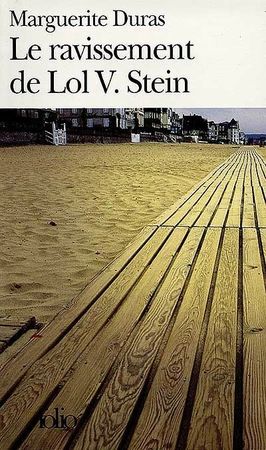







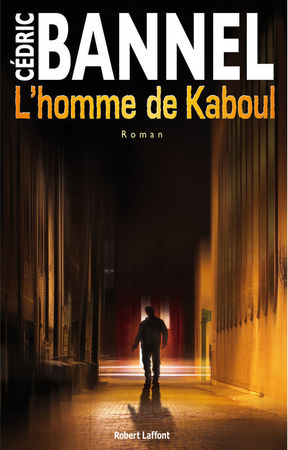


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137130.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F44%2F161948%2F9929079_o.gif)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F29%2F161948%2F8534286_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F31%2F82%2F161948%2F7723676_o.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F86%2F161948%2F7162361_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F52%2F03%2F161948%2F7162085_o.jpg)